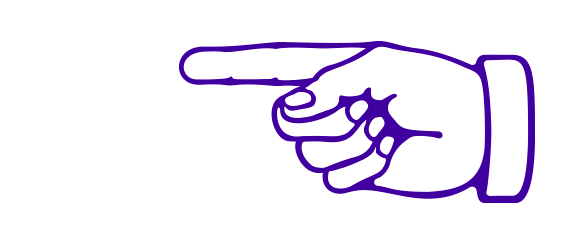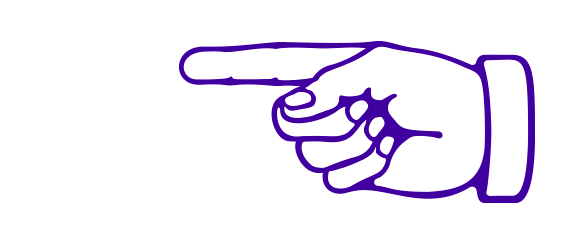

Arslane: Installation, cinéma, voyage et exotisme… Parlons d’exotisme. J’ai l’impression que depuis ton diplôme, la plupart de tes pièces ont été produites et conçues à l’étranger, notamment à M’saken en Tunisie, où tu as une maison familiale, mais tu as aussi filmé en Géorgie ? Es-ce que tu as besoin d’être ailleurs pour produire ?
Fredj Moussa: Je pense qu’il y a des pièces, des structures que j’ai besoin de réaliser sur place, en fonction de l’espace. On va dire qu’être ici, ça m’inspire pas tant que ça. Quand je pense des pièces, je pense des lieux qui ne sont pas parisiens.
Arslane: Tu dis que Paris t’inspire pas trop, tu parles de lieux. Dans le petit texte que j’ai écrit pour le dossier de presse à ton sujet, j’ai écrit que tu avais besoin d’un autre horizon pour concevoir tes œuvres. J’utilise ce mot exprès dans ton cas, par rapport au désert, qui t’intéresse particulièrement.
F: J’ai besoin de me chercher, de ce fait, je me déplace beaucoup pour trouver ce qui m’intéresse, ce qui m’intrigue. Pour cela, j’ai besoin d’horizons différents. Mes réalisations ne font ainsi que traverser un lieu, se sont plutôt des transits, des sortes de translations de choses qui ont été produites quelque part et je les fais se déplacer. Ça m’intéresse pas mal d’avoir ces images qui se déplacent, mais je ne crois pas produire quelque chose d’exotique, finalement…
A: Moi, je voyais ça du point de vue du spectateur, en fait. C’est que le spectateur, on ne sait pas forcément d’où il vient, mais s’il habite en France, il peut y avoir une connotation exotique que ce soit par rapport à la Tunisie ou à la Géorgie. C’est des coins qu’on ne connaît pas trop : la Tunisie reculée, donc le désert… Il y a une imagerie, qui peut être vraiment exotique.
F: Complètement.
A: Sur un paquet de couscous on voit un désert, avec un chameau.
F: oui oui, complètement. Je trouve important de réinterroger ces clichés. Par exemple, lorsque j’ai tourné Life style of…, une vidéo que j’avais présenté au diplôme et que j’avais travaillé avec deux Ivoiriens qui venaient d’arriver en Tunisie. J’avais vu en amont pas mal de vidéos qui avaient circulé en France sur les migrants et je me disais que c’était pas mal de repenser l’image qu’on a du migrant, qui est automatiquement associée, en tout cas en occident, à certaines idées. Par conséquent, je pars de ces a prioris et j’essaie d’en faire ressortir quelque chose de plus fidèle à la réalité, de plus complexe, en faisant des détours et en passant par la fiction.
A: Mais est-ce que le but quand tu utilises ces clichés, c’est de rétablir une vérité ? Ou est-ce que c’est autre chose ?
F: Je détiens pas la vérité. À la fin d’une vidéo, je n’en ressors pas avec une solution, avec une vérité. Je pense que ça remet en avant certaines problématiques. Après, c’est le spectateur qui doit faire le travail de… réfléchir là-dessus.
A: Tu parlais de ces deux ivoiriens que t’as rencontré et de l’image préconçue qu’on en avait. Comment tu déroules le reste de ton fil ? Et comment tu joues avec ces préconceptions ?
F: Au début, j’étais parti avec ma caméra pour deux semaines en Tunisie et je m’étais donné une région. C’est comme ça que j’en étais arrivé à les croiser par hasard dans la campagne. Ce n’est pas venu tout de suite l’idée de faire cette vidéo. Au début, on a commencé par boire un café en ville, on a vu que c’était pas évident de discuter à cause du racisme trop pesant. On s’est alors retrouvés de nouveau en campagne et pendant plusieurs jours, on posait juste la caméra. Elle filmait toute la journée. C’était surtout des tentatives de raconter autre chose à partir de ce point de départ. Et je suis arrivé à Paris comme ça avec des dizaines d’heures de rushs et sur lequel j’ai choisi une version. Il y avait pas mal de possibilité, j’ai donc juste fait un choix au montage et finalement ça s’est réalisé... Je n’ai pas dirigé j’ai juste posé la caméra et ça s’est fait.
A: Mais comment « ça s’est fait »? Qu’est-ce que vous vous racontiez à ce moment ? T’as quand même dû leur expliquer ce que tu cherchais, non ?
F: Je savais même pas concrètement ce que je cherchais. Je savais juste une chose, c’est qu’ils venaient d’arriver de Côte d’ivoire. Ils avaient pris l’avion pour arriver à Tunis, et ils se sont retrouvés là, en attendant, dans l’idée d’aller en France. Et moi, j’ai plutôt fait le chemin inverse, je venais de France, donc c’était un point de rencontre. On a choisi un premier élément qui était leur voyage de nuit en avion à travers le désert.
A: Vous avez écrit le scénario à trois ?
F: Au début, on a essayé de composer ensemble. Ils ont décidé de continuer en dehors de ces moments de captations et un des acteurs, Hamed, m’a envoyé un message : c’était l’histoire. À mes yeux, c’était assez flagrant que c’était inventé. Mais finalement, à mon retour, je voyais quand même que ces stéréotypes étaient assez ancrés. Il y avait des personnes qui n’arrivaient pas à prendre de recul. Ils parlent par exemple d’un âne qui est mort à mi-chemin et on le retrouve plus tard dans la vidéo. Il y a quelque chose de déconstruit, ça n’a pas vraiment de sens. Et il y avait quand même quelques personnes qui ont pleuré et qui pensaient vraiment que les migrants avaient traversé le désert. Enfin, mon idée c’était pas de jouer sur la culpabilité des gens, mais …
A: C’est aussi de l’apitoiement de la part de ces gens… C’est peut-être un peu condescendant, du genre : « Miskin, le pauvre… »
F: C’est ça, exactement. Je commence à m’intéresser de plus en plus à ce concept du miskin en partant de la ville de M’saken. Miskin est bien connu en français, n’est-ce pas ? L’origine du nom de la ville, M’saken, c’est résidence, habitation. Mais dans le langage courant, M’saken, c’est des pauvres gens. Et il y a toute une mythologie à partir de cette ville. À chaque fois que je vais dans une ville et que je dis que je viens de M’saken, on les prend vraiment pour des gens pauvres voir dangereux d’après certaines histoires. Ça m’intéresse pas mal. Réinterroger ce que c’est le miskin, le pauvre, la place du spectateur et essayer de reconstruire quelque chose à partir de ça.
A: Mais par rapport à Life style of…, justement, le spectateur, de ce que j’en comprends, il n’avait pas forcement la compréhension du coté fictionnel de ce que tu faisais. Il prenait ça pour un documentaire.
F: Finalement, il s’avérait que c’était de très bons acteurs. Quand, l’un d’eux est sur le point d’éclater de rire, on a l’impression qu’il va éclater en sanglots. Il y a des spectateurs qui arrivent à réaliser ce que c’est, d’autres non. Ça pose un problème déontologique à certains, d’autres non. Mais je crois pas que ce soit ça la réelle problématique. Je pense que ça va au-delà. En fait, ces personnes, elles n’ont pas besoin qu’on s’apitoie sur leur sort, surtout que là, ce n’était pas des personnes qui avaient connu toutes les péripéties qu’on peut s’imaginer.
A: Mais quand tu as fini le film, tu étais conscient de ça ?
F: Non, j’en avais pas conscience. Quand j’ai vu la version finale, j’étais sur place et je me voyais avec les acteurs, c’est pas évident. Je savais pas que ça pouvait aller jusque-là. Quand tu filmes, tu ne réalises pas du tout ce que tu es en train de faire, et même après, pendant le montage.
A: Avec cette histoire de miskin, t’as a un nouveau projet en cours. Tu peux m’en parler ?
F: Je travaille sur ce projet depuis la sortie d’école. Et c’est dans le prolongement de mon projet de diplôme. Pour le coup, je vais plus loin que la ville de M’saken, dans une ville du sud qui a été créée à l’origine par des Berbères. Je m’étais alors interrogé sur l’origine de ce mot : barbarie. Quand j’étais en Grèce, j’ai compris que ça venait de barbaros, un mot pour désigner toutes les personnes non-grecques dans l’antiquité. C’étaient les étrangers. Mais en grec, il n’y a pas de majuscule à barbare. Ce n’est pas un terme péjoratif. On est toujours le barbare de quelqu’un. Mais c’est devenu bien différent ensuite. Il y a une bonne partie du projet qui se base là-dessus, sur la notion d’étranger. Aussi, cette région a été judaïsée. Il y a même un chemin qui m’intéresse, où je vais tourner, qui s’appelle le chemin du pharaon, qui fait référence à l’exode de Moïse. Pour eux, ça s’est passé là-bas.
A: Est-ce que tu t’intéresses plutôt à déconstruire les catégories, les lieux-communs ou bien, est-ce que tu veux étudier les monothéismes et leurs histoires, leurs liens ?
F: Je cherche pas à trouver un espace où ils se rejoignent tous et où finalement on est tous pareils, tous des êtres humains kif-kif et on va tous vivre heureux. Non, c’est l’opposé qui m’attire. C’est cette dualité. Ça crée toujours quelque chose de valorisant. Et ça nous permet d’envisager que la rencontre avec l’étranger peut être un véritable antidote à l’ethnocentrisme.
A: Tu parles de vidéo dans l’espace d’exposition, de la place du spectateur… C’est quoi la relation de la vidéo avec la sculpture, ce serait quoi ta grammaire à ce niveau ?
F: En général, la meilleure façon, c’est de l’envisager au cinéma dans une salle noire, avec l’immersion, la 3d, ou tout ce que tu veux… Mais je crois que c’est bien aussi de pouvoir circuler autour de la vidéo, de prendre de la distance, d’y revenir. C’est ça qui est très frustrant avec le cinéma. Tu ne peux pas faire de pause, sortir, ou y revenir ! La vidéo, c’est différent. En fonction de l’architecture de la vidéo, j’essaye de penser à une structure avec une assise qui peut accueillir un ou plusieurs spectateurs et qui soutient la vidéo en même temps. Mais j’aurai tendance à pas définir les structures qui portent les vidéos. Au contraire, elles ne sont pas définissables. Je les dessine au moment où je les fais. Enfin, tu connais comment je sculpte, je soude par-ci, je soude par-là, je recoupe, je recoupe et je recoupe.
A: Mais est-ce que c’est des sculptures pour toi ?
F: Quand j’ai récemment été invité à la conférence Towards sharing common futures, orienté design, je me suis demandé en quoi c’était pas du design ce que je faisais ? Je crois que d’une certaine manière, j’envisage ça comme du design. Je fais des supports, des chaises, et puis c’est tout. Et si tu met ça dans un musée, ça devient une œuvre, si tu veux. Mais pour moi, c’est juste une captation. L’image et la structure, c’est la captation de quelque chose que je retranscris d’une certaine manière.
A: Donc, ce que t’appelles sculpture et structure… c’est des captations aussi ?
F: C’est quelque chose que j’ai capté et que j’essaie de retranscrire à un moment et je sais que ça peut ne plus être valable dans un an. Je ne l’envisage pas comme une pure sculpture, quelque chose de figé, qui ne bougerai pas. Au contraire, ça évolue et si je la représente, la pièce peut être différente.
A: Un autre lien entre sculpture et video que je remarque, c’est que tu filmes tes sculptures. Tu l’a fait avec ton panneau lumineux, construit au milieu d’un terrain vague et alimenté par un groupe électrogène, et tu l’as fait dernièrement, dans une perspective plus théâtrale, avec le masque que tu fais porter à tes petites cousines à M’saken. Est-ce que ces sculptures sont présentables hors de la vidéo, pour elle-même ?
F: Tu veux dire comme du land art ? Tu penses par exemple au panneau lumineux qui illumine la brousse tunisienne ? Non, je pense que la vidéo crée quelque chose qui est différent de la réalité. Par rapport au panneau lumineux, la plupart des gens se l’imaginent dans le désert. Ça crée tout un imaginaire, vraiment. Dans la réalité le plexi a sauté parce que des chiens sont rentrés dedans… J’aime beaucoup le land art, mais je trouve ça aussi absurde de construire des trucs pharaoniques. Je crois qu’il n’y a pas besoin de créer quelque chose qui va rester et durer dans le paysage. Donc, ça fonctionne en tant qu’image seulement. Si on retourne sur le lieu, on ne va pas retrouver grand chose de ce mur par rapport à la vidéo
A: Tu parlais de transit au détour d’une phrase en parlant de tes pièces et leur place dans les expositions…
F: C’est comme un espace de stationnement, un endroit où ça va être présenté, temporaire. Elles vont repartir et les structures sont juste là pour les accueillir un temps.
A: Tu peux me parler un peu de ce que tu prépares pour l’exposition ?
F: Ce projet (1), je l’avais tourné l’été dernier. Mes petites cousines étaient à ce moment-là à M’saken. J’étais aussi rentré en Tunisie et je faisais des recherches sur des dessins préhistoriques qui ont été trouvés dans le coin. Je me disais qu’il y avait quelque chose à faire ensemble. Je trouvais que là, plutôt que de créer des structures en acier, pourquoi pas les faire porter par des personnes, pas de faire des structures immobiles. Et finalement ce qui fonctionnait sur place, c’était quand elles ne se déplaçaient pas, quand elles étaient immobiles et qu’elles portaient ces masques. Lorsque j’eu cette proposition pour le 6b, pour Bouphonie, pour moi, c’était une révélation, elles vivent depuis toujours à Saint-Denis. Ça collait bien avec ce que je veux faire depuis ces dernières années, de travailler avec des personnes à proximité.
A: Cette idée, ce dispositif, ce thème qu’on a mis en place, je sais même pas comment appeler ça. Comment tu te vois par rapport à tout ça ?
F: Je vois ça comme une plateforme où chacun intervient et quelque chose va se créer. C’est un point de rencontre pour une scène émergente. Je ne peux pas rêver mieux. Quand je vois des expos, ce que je préfère, c’est la fraîcheur. Il y a du tâtonnement, de la recherche, on se remet en question. Donc oui, des fois, il y a des accidents et pas mal de ratés, mais il y a parfois quelque chose d’intéressant qui peut se créer. Ça fait pas mal de temps que je voulais faire quelque chose à Saint-Denis et l’idée, de décentraliser, de ne pas être à Paris, que ça se passe ailleurs me tient à cœur. Je pense vraiment que ça peux se passer ailleurs.
1. Confiné aux Pays-bas, Fredj n’a pu montrer le film qui complètait l’installation présente sur l’acte +1 de Bouphonie
Visitez le site de l’artiste